![]()
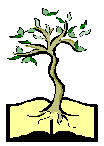
MAJ Page le 02/03/08
|
Georges Duic
|
||||
|
||||
|
L’épuisement des stocks Quand j’ai commencé vers 1950, il y avait quelques chalutiers, mais pas beaucoup. Gavres remontait la tête avec la sardine, car les gens commençaient à gagner de l’argent. Avant, les patrons pêcheurs avaient des petites maisons, des petits bateaux, ils ne gagnaient pas trop. Ils entretenaient difficilement leurs bateaux, qui parfois n’étaient jamais repeints à l’intérieur pendant 20 ans. Quand la sardine est arrivée avec la bolinche, les stocks avaient été reconstitués en raison de la guerre. Autrefois, en été, quand j’étais gosse, en se baignant ou en marchant un peu dans l’eau, on mettait le pied sur du poisson. On attrapait des tarches, des soles… Les pêcheurs avaient des filets en coton, des gros filets, ils pêchaient beaucoup de poisson. Maintenant, il y a des filets super invisibles et une surexploitation des stocks, depuis l’avènement du filet pélagique en 1976-1978. Avec des collègues, nous avions créé contre le chalutage pélagique un groupement à Etel, dont j’étais le président, et rédigé une pétition nationale signée par 1.800 patrons pêcheurs de Brest à Hendaye. Le ministre de l’Intérieur était d’accord pour arrêter le chalutage pélagique, mais cela n’a duré que 15 jours à l’été 1978. Selon mes estimations, qui avaient été publiées alors dans la presse, il ne devait plus y avoir de poisson sous les quinze ans. Maintenant, depuis les années 1980, sans subvention, un pêcheur ne peut plus vivre, ne peut plus construire un bateau. Les chaluts pélagiques étaient énormes, encouragés par l’office des pêches (actuellement IFREMER). Ils faisaient 140 m de long, 40 m de hauteur, tirés par deux bateaux à la vitesse double des nôtres, avec des petits maillages. En 4 à 5 ans, ils ont tout ravagé. Ca a commencé par deux bateaux à Lorient, cinq paires à La Turballe, avec des gens ambitieux, séduits par le discours et les subventions de l’office des pêches. En un coup de chalut, ils faisaient 30 à 40.000 francs, 15 à 20 tonnes de poissons de toutes sortes. Nous, on ne pêchait pas la même chose, c’était la langoustine et la sole. Eux, c’était la sardine, les merluchons, les dorades, le bar jusqu’à 30 tonnes ! Il aurait été suffisamment temps d’arrêter en 1978, ou de limiter le nombre de bateau. Au début, ils faisaient un coup de filet par nuit. Au bout de trois à quatre mois, deux ou trois coups pour obtenir le même tonnage. Au bout de deux ans, ils pêchaient nuit et jour. Le stock a donc diminué en très peu de temps. On ne pêchait même plus une dorade à la côte. Les pêcheurs pélagiques n’ont pas pensé aux générations futures et ont mis en difficultés les jeunes patrons arrivés plus tard dans les années 1990. Même si nos bateaux étaient importants, nos chaluts étaient plus petits, ils ouvraient au maximum 15 mètres, la corde de dos levait à environ 80 cm à 1 m. En pêchant la langoustine, on gagnait déjà bien notre vie.
|
||||
|
La langoustine, le sommeil Avec
la flotte industrielle, il n’y avait pas de concurrence, ce n’était
pas la même pêche, la même vente, le même monde, un peu comme les
terre-neuvas de Saint-Malo. On ne connaissait même pas les patrons, ni
les matelots, et eux non plus ne s’intéressaient pas à nous. On
pêchait la langoustine et le merluchon principalement, un peu la sole,
et en saison la sardine. Le pêcheur se réveille avec le soleil, cela dépend
des époques et de la saison, en général l’hiver à 5H, l’été à
3H. Si on veut faire une belle journée, il faut se mettre en pêche
avant le lever du jour, on travaille toute la journée, et on vire quand
le soleil se couche. La langoustine se pêche pour le premier coup ou
trait pendant les trois premières heures de la pointe du jour. Dans la
journée, il y en a moins, surtout s’il fait beau. Mais quand le temps
est plus mauvais, sans trop de houle quand même, il s’en pêche un
peu. En plein été, il ne s’en pêche que le matin et le soir, rien
en milieu de journée. Le plus dur dans le métier, c’est le manque de sommeil, car cela fait de grandes journées, notamment en été et pour les patrons qui sont à la barre du matin au soir. Les matelots eux peuvent se reposer un peu entre deux coups de chaluts. Parfois, dans une semaine de 5 jours, je ne dormais pas 20 heures. Quand j’arrivais à Keroman, je m’allongeais sur la couchette, et je m’endormais instantanément.
|
||||
|
La vente à l’amiable Lorient était le seul marché français où on vendait à l’amiable, de gré à gré avec les poissonniers. Au début du marché, on demandait cher. Quand ça ne marchait pas, on diminuait le prix. Ce système était avantageux, plus rentable pour les petits pêcheurs, qui n’avaient pas de grandes quantités, mais beaucoup de variétés et une belle qualité.
|
||||
|
L’armement à la sardine, les essais au lamparo J’ai connu les trois usines de Port-Louis, Delassus, Brezin et Guyader, qui ont fermé vers 1965 ou 1966. La sardine commençait dans la première quinzaine de mai. Les petits bateaux gavrais, qui ne faisaient que la sardine, testaient la présence du poisson. Dès que celle-ci était confirmée, l’annonce se répandait rapidement parmi les chalutiers en mer. Ceux-ci ne finissaient même pas leur journée. Ils préféraient virer route terre pour désarmer. On démontait en mer les fermes (potences métalliques pour tirer les chaluts), qui gênaient pour la bolinche. C’était un peu comme la ruée vers l’or, il n’y avait pas de fainéants, on allait chercher la senne qui était dans grenier du patron, il fallait la porter (sans voiture), aucune corvée ne pouvait arrêter, tout se faisait dans la journée même. Dès le lendemain matin, on mettait en pêche pour la sardine. Il n’y avait pas de fausse alerte, mais les bancs n’étaient pas toujours abondants. Une fois le bateau armé pour la sardine, c’était normalement pour tout l’été. Pour les matelots, ce n’était pas très grave. Pour le patron, qui avait des gars mariés avec lui, des responsabilités, c’était différent. Sur les cinq jours de la semaine, quand il n’y avait pas de sardine, il n’y avait rien à partager le samedi pour l’équipage. Pour le patron, les frais s’accumulaient parfois deux semaines, trois semaines, jusqu’à cinq même. Les bateaux qui pouvaient repartaient alors au chalut, la mort dans l’âme. C’était les aléas de la pêche à la sardine. En
1962, alors que j’étais patron, l’office des pêches a demandé à
deux pêcheurs d’ici de partir à Sète pour voir comment on y pêchait
la sardine au lamparo. Comme le père d’Alain s’est désisté,
j’ai pris sa place et on a vu là bas comment ça se passait la nuit.
Ensuite, nous avons été subventionnés pendant 14 à 16 semaines. On
gagnait 360F par semaine, en plus d’une partie de la pêche, et de ma
part normale de patron à l’armement. J’avais acheté une bolinche
neuve (senne) à la biennale de Lorient (une foire des pêches), de
couleur rouge vif, une belle, une grande. Donc, on est parti au lamparo,
ça a bien marché, on avait de sacrées pêches. Dans le midi, c’était
le lamparo à gaz, mais pour nous ce n’était pas assez puissant, car
l’eau est moins claire et moins plate ici. Nous avions donc des
groupes électrogènes, avec des lampes immergées dans l’eau pour éviter
une perte de luminosité avec la réverbération. Le spectacle était
formidable. Le poisson brillait dans un anneau d’argent en pleine
nuit. L’expérience n’a duré qu’une saison. Les Turballais nous
faisait un peu la guerre, et c’était compliqué aussi avec l’électricité,
les lampes sautaient parfois en cas de fuite. Il fallait un canot avec
des rames, un groupe. Au bout d’une heure ou plus, on voyait s’il y
avait du poisson, on tournait alors autour du canot, qui passait ensuite
par-dessus la senne. On a fait des coups de 50.000 sardines. Mais le
poisson tenait moins bien d’autant plus qu’on était en été, il
s’écaillait plus vite, on n’avait pas de frigo.
|
||||
|
La vente On comptait les sardines jusque dans les années 1960, et on les vendaient ainsi, plutôt bien, par exemple 16.000 ou 18.000 anciens francs le mille, soit 16 ou 18 centimes la sardine. Ca faisait 25 sardines au kilo à 30F. Maintenant, 40 ans après, ça ne fait même plus 3F le kilo. La grosse ne se vendait par forcément la plus chère, au contraire. Il y avait la sardine pour griller, du 25 ou 30 au kilo. Je vendais souvent aussi aux revendeuses dans les rues. Je connaissais aussi des poissonniers de Pontivy, les Gourierec, qui vendaient 60.000 sardines dans sa journée avec deux camions à travers la campagne. Une pêche de 20 milles sardines était très jolie, environ 1000 à 1500 kilos. Vingt ans plus tard, la pêche de nuit à la bolinche, une tonne ne comptait plus en raison du prix très bas. Le premier bateau vendait parfois deux fois plus cher que le dernier. On était environ 35 gavrais à pêcher, mais il y avait aussi 50 de Doëlan, Concarneau, Douarnenez. Tout le monde vendait à Keroman, et pêchait au même endroit. C’était un peu comme un jeu de carte. Après un coup de filet, par exemple de 15.000, il fallait savoir si on si rentrait au port pour vendre cher, ou si on continuait à pêcher pour vendre plus mais moins cher. Il fallait être rapide pour rentrer en premier, c’était la course. Quant j’étais matelot, on embarquait les canots, mais certains les lâchaient pour aller plus vite et les récupéraient plus tard. Parfois, le premier n’avait que 20 mètres d’avance au quai sur le suivant, qui devait se contenter de vendre 20 ou 30% moins cher. Après une certaine heure, les poissonniers, qui achetaient au meilleur prix, n’étaient plus là. (Maintenant la sardine n’est plus prisée, notamment en raison de l’odeur et des habitations collectives plus nombreuses). Le 30 au kilo ne se vend plus bien, le 15 mieux, plus grosse, plus facile à griller. Elle supporte mieux le voyage, notamment un traitement de bain d’eau glacée et salée. Les italiens ont ainsi envoyé en Bretagne du poisson, moins bon, mais aussi beau que le nôtre.
|
||||
|
La rogue, la cotriade, le chalut La rogue s’est terminée vers 1966 ou 1967, à l’époque de la pêche de nuit. Elle était très chère, 30.000 à 50.000F (anciens) le fût, alors qu’on jetait un et demi, parfois deux fûts dans la journée. En une semaine, il fallait environ 8 fûts, plus 12 à 14 sacs de farine de tourteau. Il y avait aussi les charges sociales pour 8 hommes, le gas-oil. Le métier était plaisant, on gagnait bien, mais à un moment, le chalut était plus rentable, plus sûr, plus régulier. |
||||
|
||||
|
Avec le chalut, on pêchait toujours quelque chose, une semaine moyenne, une semaine formidable. Avec la sardine, il y avait des semaines folles, d’autres sans rien. Il y avait aussi des meilleurs pêcheurs que d’autres. La pêche de la sardine se poursuit toujours à Quiberon, mais à Gavres, elle s’est arrêtée progressivement vers 1970 avec la fin des usines, à part la Belle Bretonne, le dernier sardinier, qui ne faisait pas le chalut ( jusqu’en 1985 environ ?). Il avait deux usines à Gavres, beaucoup plus à Quiberon, et même dans les terres, à Plouharnel, à Hennebont.
|
||||
|
Les parts Le
partage des bénéfices était un rituel autrefois, en particulier,
parce qu’on ne savait pas compter. Le vieux réglait. A l’époque où
je pêchais le tacot avec mon père, on faisait sept tas, un par
personne. On mettait sept gros poissons, sept moyens, et ainsi de suite
jusqu’à ce qu’il n’y en ait plus, puis l’argent en commençant
par les gros billets et finissant par les petites pièces. Ce n’était
plus comme çà, lorsque j’étais patron. De la vente, il fallait
tirer tous les frais, à savoir les charges sociales de l’équipage,
le gas-oil, la rogue, le vin du bistrot. Le bénéfice net est ensuite
partagé. Chaque homme, compris le patron, compte pour une part, le
bateau pour cinq parts. Si l’équipage comprend sept hommes, il y a
donc douze parts. A Douarnenez, les matelots embarquant avec leurs
filets avaient une demi-part supplémentaire. Les veuves, qui prêtaient
des filets, avaient aussi une demi-part. Tout ceci diminuait donc
proportionnellement la part du bateau, de même qu’un équipage
important. Ici, au chalut, c’était plus rentable pour le patron, car
on était six, il n’y avait que onze parts. Le petit mousse de 15 ans
avait une demi-part, puis assez rapidement trois quarts. Mais à la
sardine, lorsqu’il avait 18 ans, même s’il ne savait pas ramender
les filets, il avait une part entière ici, car il était aussi fort
qu’un matelot, il travaillait dur. Il y avait des étudiants et toutes
sortes de gens qui venaient à la bolinche. Il fallait être courageux,
assez fort, tirer dessus et porter les caisses, sans compétence spéciale.
J’ai même connu un maître charpentier naval qui pêchait tous les étés
avec Jacob, le meilleur patron de Quiberon. Il pouvait gagner en été
cinq fois ce qu’il gagnait normalement. Au chalut, il fallait plus de
compétences, mais on donnait quand même une part entière aux gars de
plus de 18 ans, d’autant plus qu’ils apprenaient assez vite.
|
||||
|
Technique de pêche de la sardine A la sardine, il y a une annexe, puis deux. Avec deux, le patron n’allait plus roguer ou bouetter, il se faisait remplacer sur l’annexe par un matelot avec le brigadier qui ramait. Le patron nous lâchait, on se mettait de bout au vent, on ramait très peu, on se laissait dériver un peu au courant. La rogue jetée faisait une tache de gras (ou larden), qui devait se situer juste au niveau du bateau, ni trop derrière, ni trop en avant. Lorsqu’il y avait du vent, il fallait des types costauds pour ne pas culer le canot. Lorsque le poisson montait en brillant, on faisait signe au bateau. Celui s’approchait alors, jetait une bouée avec du filin, filait environ 20 mètres, tournait autour du canot en jugeant une longueur maximum de 65 mètres, récupérait la bouée qui s’était déplacée entre temps, laissait le canot sortir du piège en passant dessus, coulissait le filet avec des anneaux pour le fermer par le bas, puis remontait le filet avec une perche. La manœuvre prenait environ une demi-heure. Lorsqu’il y avait deux canots, c’était la même chose, chacun son tour, l’un appâte, l’autre manœuvre avec le bateau. Lorsque la manœuvre était trop longue, le canot qui appâtait devait tenir le banc, qui grossissait ou diminuait. Maintenant c’est terminé, même à Quiberon. La pêche se déroule de nuit avec des détecteurs latéraux, des sonars qui balaient jusqu’à 300 à 400 mètres. Le bateau n’a même pas besoin de passer au-dessus du poisson. Il s’approche à 30 mètres, file sans effrayer le banc, le contourne… L’appareil coûte 500 ou 800.000 francs ! Je n’ai connu que le sondeur, pas de tels sonars. Concarneau a plusieurs bateaux équipés ainsi.
|
||||
|
Les filets A Concarneau, il y a un bateau de 21 mètres, qui a déjà fait 7 à 8 millions de francs de vente depuis le début de l’année avec une senne immense. Les sennes font maintenant 300 mètres, avec une chute de 70 mètres, alors que les premières de Gavres faisaient 60 m de long sur 30 m de profondeur, puis elles sont passées à 120 m sur 38 à 40 m. Certaines étaient plus pêchantes que d’autres, même si le patron était bon. Avec Martial, on ne faisait guère plus de 200 kg par coup (à 25 le kilo, soit 5 milles), d’autres, pêchait beaucoup plus avec des filets d’autres fabriques. On pouvait faire cinq coups dans la journée. Encore merci à Georges.
|


